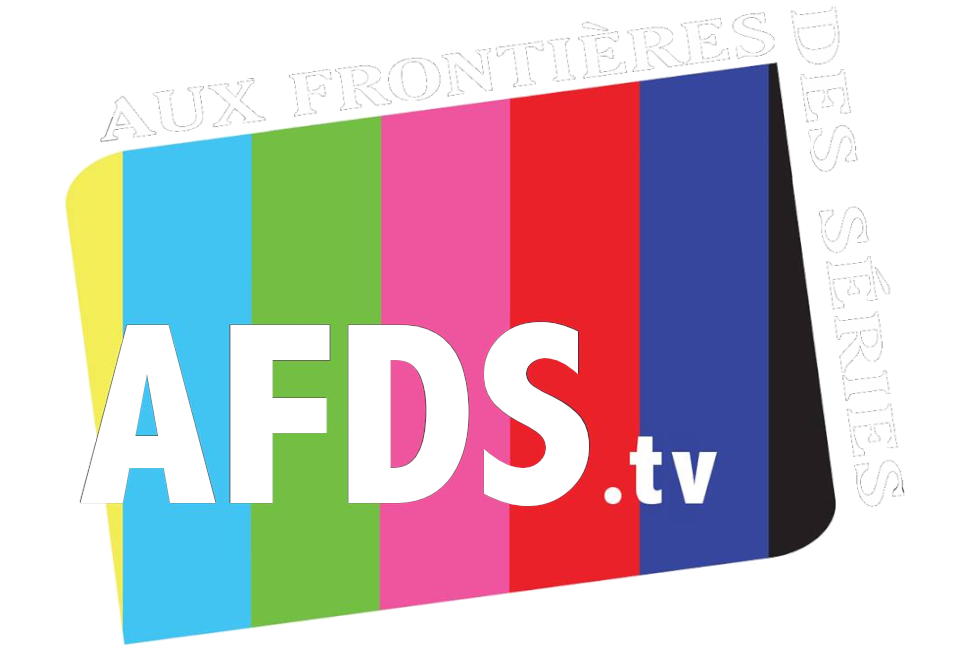Deadwood

Deadwood est arrivée tardivement sur nos écrans européens. En fait, Deadwood semble avoir fait peur. Sur le site tele.ados.fr, David prétend que Canal + l’avait déjà achetée plus d’un an avant de la diffuser, mais que le directeur des programmes, gêné par la petite vertu qui s’en dégageait, l’a programmée à 3 h 40 du matin. C’est aux fans que la série doit d’avoir trouvé une case plus convenable par la suite.
Aux Etats-Unis, la série est diffusée sur HBO (où d’autre pourrait-elle avoir été diffusée, je vous le demande!). Elle compte 3 saisons de 12 épisodes chacune.
Deadwood: présentation
La série débute dans le Montana. Seth Bullock est shérif. Il vient d’arrêter un voleur de chevaux qui tente de le corrompre. Il refuse. Les fermiers volés par cet homme débarquent et veulent se faire justice. Bullock n’a d’autre choix que de le pendre lui-même pour éviter qu’ils le capturent et le tuent trop lentement.
Cette nuit-là, Seth quitte le Montana pour Deadwood. Cette courte scène permet de comprendre que Bullock en a marre d’être shérif, que faire respecter la loi envers et contre tous est un métier trop prenant pour cet homme qui est irrémédiablement honnête et incorruptible. En s’installant à Deadwood, il espère recommencer à zéro, faire un métier sans responsabilité. Deadwood est l’endroit idéal.
Le général Custer y a trouvé de l’or en 1864, mais le gouvernement américain a étouffé la nouvelle pour éviter que des milliers de chercheurs d’or n’envahissent les collines qui appartiennent toujours aux indiens. Mais plus de 10 ans plus tard, l’économie est au ralenti, les relations avec les indiens se sont dégradées, alors le gouvernement répand l’information. Les chercheurs d’or affluent.
En juin 1876, le général Custer se fait massacrer avec 250 soldats à Little Big Horn. Ce sera le dernier fait d’arme des indiens avant qu’ils soient exterminés. Mais en attendant la capitulation des peaux rouges, les blancs arrivent en masse dans la ville qui est toujours officiellement hors du territoire des Etats-Unis.
Seth Bullock, Sol Star, Charlie Utter, Calamity Jane et Wild Bill Hickok arrivent à Deadwood une semaine après le massacre de Little Big Horn. Bientôt la ville sera rattachée au territoire, mais en attendant, l’endroit est idéal pour se faire une place au soleil.
Au début de la série, on fait la connaissance de la communauté qui vit à Deadwood. Seth et Sol s’installent comme quincaillers. Ils louent une parcelle de terrain à Al, avant de l’acheter et d’y construire leur magasin.
Wild Bill Hickok est venu à Deadwood pour se refaire une santé financière au jeu. Il est déjà une légende dans l’Ouest et sa présence va susciter la curiosité, l’admiration et les jalousies. Charlie, son ami, veut monter une compagnie de transport de marchandises et de courrier. Jane a suivi son meilleur ami, Hickok. Elle n’a d’autre but dans la vie que de se saouler à longueur de journées.
Si la ville n’a pas de loi, pas de shérif, pas de maire, elle est cependant dirigée dans l’ombre par Al Swearengen. Al est le patron du saloon Gem. C’est un homme très intelligent et implacable. Il sait s’entourer (Dan Dority, Eustace Bailey Farnum, etc…) et comprendre avant tout le monde d’où la tempête va venir.
Il est très attaché à Trixie, une pute de son établissement qui tombera sous le charme de Sol Star. La ville compte d’autres résidents comme A. W. Merrick, le journaliste et rédacteur en chef du journal, le docteur Cochran marqué par la guerre civile ou le révérend Henry Weston Smith. On y trouve également des personnes de passage comme le couple formé par Brom et Alma Garreth, de riches new-yorkais venus acquérir une parcelle pour prospecter.
Au fil de la première saison, le nombre de personnages ne cesse d’augmenter à l’image de la formidable expansion de la ville. Durant les six premiers mois de son existence, la démographie de l’endroit est passé de 0 à 10.000 habitants. Cy Tolliver, accompagné de Joanie Stubbs et Eddie Sawyer, y vient pour ouvrir le second saloon de la ville, le Bella Union. Il s’oppose directement à Al. Il décide cependant d’investir un créneau un peu différent puisque ses prostituées sont propres et il possède des tables de jeu. C’est donc un établissement de luxe.
La plupart sont attirés à Deadwood par l’appât du gain. D’autres, comme Seth, y voient une chance de repartir à zéro. Comme Alma qui espère échapper à un mariage de raison, contracté pour racheter les dettes de son père. Mais on n’échappe pas facilement à son destin. Seth reste un homme qui croit à la justice, comme c’est le seul à Deadwood, il sera rapidement pressenti pour devenir shérif. Alma ne peut pas renier son père et son passé aussi facilement.
Evidemment, leurs vies s’imbriquent. Certains s’allient, d’autres s’opposent, la plupart doivent s’apprivoiser réciproquement. Le gouvernement ne va pas laisser cette ville sans loi se développer sans lui très longtemps. La plupart des membres de la communauté l’ont bien compris. Ils décident donc d’organiser eux-même un semblant d’autorité locale. Ils espèrent ainsi que le gouvernement reconnaîtra leur organisation sans trop y regarder. Une manière de conserver le contrôle.
Seth Bullock semble être le héros de cette fiction. C’est avec lui qu’on entre dans la ville et il est celui que l’on suit le plus souvent. En plus, il ressemble le plus à un héros typique de western. Il semble également s’opposer à Al. D’un côté, l’honnête représentant de la loi et face à lui, le mafieux corrompu. Mais il ne faut pas se fier trop aux apparences. Al n’est pas toujours sans morale. Il est attaché à Trixie et se révèle vulnérable quand elle n’est pas là. Il s’occupe également du révérend quand il agonise, même si pour donner le change il râle.
On sent que Seth n’est pas tout blanc. La plupart du temps, il paraît en colère, sourcils froncés, parfois même il est carrément asocial. Timothy Olyphant, l’acteur qui l’incarne, semble annoncer une facette différente du personnage. « Je pense que Seth Bullock est une homme très dangereux, un homme violent, un homme mu par une grande colère et quelqu’un à craindre. Mais c’est aussi un homme qui a une conscience, et je crois que c’est ce qui le sépare d’Al Swearengen » (traduction personnelle des propos de l’acteur publiés sur le site officiel de la série hbo.com).
D’autres personnages sont restés plus secondaires durant la première saison, mais on sent qu’ils sont importants à la narration et qu’ils sont susceptibles de s’étoffer. Le docteur Cochran par exemple, qui semble le seul à pouvoir donner des ordres à Al et qui s’intéresse (à sa manière) à Jane.
Jane, justement, qui semble faire partie des meubles… C’est un personnage totalement à la marge. Elle est saoule du matin au soir et du soir au matin, et veut arrêter de boire sans y parvenir. Elle semble détester tout le monde et elle est complètement incapable d’établir un contact normal avec les gens (elle ne fait que les engueuler généralement), pourtant elle était très amie avec Hickok et elle souffre horriblement de sa mort.
Charlie Utter se définissait également uniquement vis-à-vis de la légende de l’Ouest. Quand Billy meurt, il débute sa propre affaire, est promu chef des pompiers et se lie avec Joanie.
Alma, la veuve, a recueilli la petite orpheline et a réussi à se défaire de sa dépendance à l’opium. Elle devient la personne la plus riche de Deadwood grâce à la concession achetée par son mari. Elle couche avec Seth à la fin de la saison alors que la femme de celui-ci est en chemin pour Deadwood (en fait, la femme de son frère qu’il a épousé à la mort de ce dernier).
Western
Deadwood n’est pas la première série à prendre place dans l’Ouest américain (voir le dossier sur Au Nom De La Loi pour l’historique du western à la télévision). La série reprend le décor et les attributs du western, mais on sent qu’on est quelque part à la marge du genre avec Deadwood. Alors peut-on encore parler de western pour elle? Petit tour par la théorie…
Dans son « Que Sais-Je? » consacré au western, Christian Gonzalez nous apprend que: « Le western se présente comme la chronique de l’Ouest; il s’attache à retracer les épisodes saillants de la conquête: la migration des pionniers, les guerres indiennes, les ruées vers l’or et vers les terres, l’affrontement des shérifs et des hors-la-loi, la guerre de Sécession et ses séquelles. Pourtant il ne faudrait pas en conclure que le western est un genre historique. L’histoire n’est pas son sujet, mais seulement sa matière. Il ne se réfère pas directement à une réalité historique, mais il passe par la représentation déformante de cette réalité qu’est le mythe. Car, dès l’ouverture de la « Frontière », l’Ouest est devenu, pour les acteurs de la conquête, comme pour ses témoins, un mythe créateur de valeurs, aux vertus exemplaires. Dans le même temps que s’écrivait au jour le jour l’histoire du Far West, s’était tissée la trame des récits plus ou moins légendaires qui constitueront le western cinématographique. La légende s’était élaborée au rythme même de l’événement: héros, aventures, paysages étaient déjà en place lorsque le cinéma parut} » (Le Western, Que Sais-Je?, p. 7).
Le western s’appuie donc sur des éléments réels. L’espace est l’Amérique marquée par la frontière des 13 états originels. Le western est également limité dans le temps. Il couvre une période qui s’étend de 1840, les premiers grands convois d’immigrants qui se dirigent vers le lac salé d’Utah, et 1890, alors que le territoire des Etats-Unis est considéré comme entièrement colonisé.
En sont exclus généralement les premiers aventuriers qui traversent la frontière (l’expédition de Lewis et Clark qui trace la première piste vers le Pacifique, les braconniers,…) et les cowboy « has been » qui ne parviennent pas à se recycler et errent à la charnière du XXème siècle.
A noter qu’on parle souvent de l’axe est-ouest, mais que le gouvernement américain s’est aussi inquiété de fixer les frontières nord (vers le Canada) et sud (vers le Mexique) de l’état. Le genre fictionnel reprend aussi les catégories de personnages tirés du réel: les pionniers (qui étaient et qui redeviendront fermiers), les cow-boys (convoyeurs de bétail), les indiens (Sitting Bull, Cochise, Crazy Horse), les hors-la-loi (les frères James, les Dalton, Sam Bass, Butch Cassidy, Sundace Kid), les shérifs et marshalls (Wyatt Earp, Wild Bill Hickok, Tom Smith).
Mais le western n’est pas une fiction réaliste pour autant. On lui a souvent reproché son manichéisme (le traitement de l’image des indiens notamment). Cette simplification, cette typification peut néanmoins se comprendre si on part du principe, comme Christian Gonzalez, que le western, c’est un peu l’épopée moderne.
« Le western c’est d’abord, par vocation, un spectacle de pur divertissement. C’est l’aventure à l’état pur, brut. Fondé sur une dramaturgie simpliste, mais d’une étonnante efficacité, il séduit par le lyrisme d’une aventure débridée aux péripéties attendues, orchestrant ses chevauchées fantastiques dans des décors grandioses et inhumains où vivent et meurent des héros romantiques et intrépides. Dans le western, l’aventure débouche fréquemment sur le merveilleux et le manichéisme sur la morale. Aussi, il se pourrait bien, comme l’affirmait le réalisateur Jacques Tourneur, que le western soit une métamorphose du conte de fées. Mais il est aussi, ne l’oublions pas, le dernier avatar des grands récits héroïques et légendaires, L’Illiade et L’Odyssée, El Canter del Moi Cid, les Chansons De Geste du Moyen Age occidental, les sagas nordiques. Il ne se borne pas, en effet, à relater la chronique journalière de la marche vers le Pacifique, il évoque aussi la dernière grande aventure de l’humanité: la découverte et la conquête d’un monde neuf dont l’homme, luttant jour après jour pour sa propre survie et surmontant tous les obstacles, sera en mesure de façonner le destin. Avec le cinéma, le pittoresque récit de la difficile colonisation du Far West est devenu une épopée aux résonances universelles » (Le Western, Que Sais-Je?, pp. 5-6).
La littérature
Le western passe d’abord dans la littérature. Les romans de James Fenimore Cooper (Les Pionniers, Le Dernier des Mohicans et La Prairie) ouvrent la voie, mais c’est évidemment la littérature « bon marché » qui assoit le succès du genre. On l’appelle la dime novel et elle fut inventée par Erastus Beadle, un éditeur. En 1860, il publie un feuilleton hebdomadaire racontant les hauts-faits des conquérants de l’ouest.
Les ventes sont telles que tout les autres éditeurs s’y mettent. Tous les grands noms de l’Ouest, les moindres faits de l’histoire et des légendes orales seront repris par la dime novel. C’est la littérature populaire qui va fixer les archétypes du genre, le « mythe » western comme l’appelle Christian Gonzalez. Selon l’auteur, ils sont principalement trois: le décor, les personnages et la panoplie.
A propos du décor, John Ford (réalisateur de western) disait: « La chose dépeinte avec le plus de soin dans le western, c’est le pays. Je pense que vous pouvez dire que la véritable star de mes westerns a toujours été le pays » (Le Western, Que Sais-Je?, p. 27). Et il est vrai qu’au cinéma, le western est l’un des seuls genres à s’attarder sur le paysage pendant des travellings entiers. Mais le western, c’est aussi les villes parsemées de lieux emblématiques comme le saloon, le bureau du shérif, le magasin.
Du côté personnage, le héros typique est inévitablement le cow-boy avide d’aventures et prestigieux. « A l’avant-garde de la civilisation, il est celui qui possède les qualités nécessaires: force, habileté, courage, loyauté, pour ouvrir la marche vers l’Ouest en défrichant à coups de revolver un territoire hostile et instaurer l’ordre social dans un espace tout entier livré au désordre. Porteur de mythe, le héros westernien engage donc contre le mal, c’est à dire contre l’anarchie représentée aussi bien par le bandit que par l’indien, un combat singulier à l’issue prévisible et que rend inéluctable la positivité de l’histoire de la civilisation américaine » (Le Western, Que Sais-Je?, p. 29).
Le héros de western a donc bien quelque chose qui le relie au passé de toute une nation. Il est aussi porteur d’un récit initiatique. Il évoluera inévitablement quand le western manichéen sera remis en question vers un héros plus controversé, controversable, voir vers un anti-héros.
Mais à côté du héros, on retrouve des figures incontournables. Le badman, le villain ou le bad guy est l’opposé et le rival nécessaire du héros. D’ailleurs, note Christian Gonzalez, dans le premier western (Le Vol Du Rapide/The Great Train Robbery, 1903), il n’y a pas de héros, mais bien un méchant. C’est un hors-la-loi à la tête d’une bande de criminels, c’est un notable qui étouffe toute une région sous sa poigne corrompue, c’est un tueur professionnel tout de noir vêtu… Les visages du méchant sont toujours plus ou moins identiques.
L’indien est aussi un personnage important dans les westerns. Jusqu’en 1950, il est sauvage, cruel, assoiffé de sang et de scalp. C’est Delmer Dave, dans le film « La Flèche Brisée » qui le premier brise cette image. C’est au moment, où les Etats-Unis commencent à s’interroger sur leur passé et que le mot génocide est prononcé. Petit à petit, l’indien, symbole de sagesse, va devenir un héros à part entière.
A côté de tous ces hommes, la femme est confinée à des rôles plutôt marginaux. Elle est soit une prostituée, une fille de saloon, soit une jeune fille vierge menacée par les indiens.
Budd Boetticher précisait le rôle exact de la femme: « Ce qui est important, c’est ce que l’héroïne a provoqué, ou bien ce qu’elle représente. C’est elle, ou mieux l’amour ou la peur qu’elle inspire au héros, ou encore le souci qu’il a d’elle, et qui le fait agir d’une certaine manière. La femme elle-même n’a pas la moindre importance ».
Ce que confirmait sans équivoque la morale qu’André Bazin tirait du Banni: « La meilleure femme ne vaut pas un bon cheval » (Le Western, Que Sais-Je?, p. 32). Charmant! La femme prendra petit à petit son indépendance en calquant le comportement masculin, mais généralement elle vivra un destin tragique. Selon Christian Gonzalez, la femme la plus libre du western est Etta, la compagne de Cassidy et le Kid dans Butch Cassidy Et Le Kid de 1969.
Dernier lieu commun du western: la panoplie. Et ça paraît tellement évident. Le western, c’est d’abord une affaire d’armes (Winchester, Remington, Smith & Wesson, arme blanche) avec le Colt 45 en vedette. On doit également citer le cheval, moyen de locomotion et compagnon, qui prend souvent l’ascendant sur la femme dans le coeur du héros!
Enfin l’habillement très codé qui permet de distinguer du premier coup d’oeil le cow-boy (bottes, éperons, Stetson, jeans), au militaire (nordiste ou sudiste), l’indien (plume, peaux d’animaux, arc et flèches), le joueur professionnel (costume trois pièces), le trappeur, la fille de saloon, la respectable mère de famille, etc…
Le cinéma
Mais ce qui va véritablement achever de faire du western un grand genre fictionnel, c’est le cinéma. Le tout premier film fictionnel sera même un western. Il s’agit du Vol Du Rapide d’Edwin S Porter.
« L’influence de ce film, qui peut être considéré comme la première histoire racontée en termes cinématographiques, fut considérable. Il apprit à tous les débutants d’alors ce qu’était un film et comment un film devait être fait. Il fut le modèle, le film type, et le demeura jusqu’à ce que Griffith donne leur premier épanouissement aux principes du montage dont il fut l’expression initiale. De plus, il orienta toute une partie du cinéma américain vers le drame réaliste ou à tendances sociales, les autres films s’attachant aux reconstitutions historiques ou à l’illustration de romans ou de pièces célèbres » (Jean Mitry, Histoire Du Cinéma, t. 1, cité dans Le Western, Que Sais-Je?, p. 39).
Certains personnages squattent littéralement l’écran comme Broncho Billy qui fut le héros de 376 films tourné par le même acteur, Gilbert Mc Anderson! Les maîtres du western muet sont Thomas H. Ince (1882-1924), James Cruze (1894-1942), John Ford (1895-1973).
Comme tous les autres genres cinématographiques, le western passe aussi au parlant. Au départ, les dialogues n’intervenaient que dans les scènes d’intérieur, les extérieurs n’étaient que « bruités ». On trouve deux types de western parlants: les films historiques (corrigés par la légende) et les films qui perpétuent la tradition des dime novels.
Les films du western classique célèbrent la conquête de l’Ouest, ses héros, leurs combats contre les méchants et pour le progrès. John Ford (notamment La Chevauchée Fantastique en 1939 ou Cheyennes en 1964), Howard Hawks (Rio Bravo en 1958) Raoul Walsh (La Piste Des Géants, La Fille Du Désert) sont les trois réalisateurs majeurs de cette époque. On voit aussi des films moins prestigieux (de Gordon Douglas, Henry Hathaway, Jacques Tourneur) et la création d’un western de série B que Christian Gonzalez juge assez sévèrement.
Mais, après la seconde guerre mondiale, l’Amérique entre dans une période de crise. Elle doute d’elle-même et le western est également touché. « Le cinéma américain subit le contrecoup de la seconde guerre mondiale. La guerre posa les termes d’une interrogation sur l’idéologie et les valeurs américaines et le western enregistra cette interrogation qui se révéla bientôt être les prémices d’une dégénérescence, d’un pourrissement du `rêve américain´ » (Le Western, Que Sais-Je?, p. 74).
On nomme cette époque le « sur-western », un sous-genre plus polémique, « symptomatique de la dégradation des mythes et de l’évolution du genre, désormais plus lucide » (Le Western, Que Sais-Je?, p. 74). L’Etrange Incident de William Wellman (1943) est le précurseur de cette veine. Il s’interroge sur la société sans loi de l’Ouest (les pendaisons arbitraires). Delmer Daves est probablement le plus connu, il réhabilite l’indien dans le premier western pro-Indien du cinéma, La Flèche Brisée (1950).
Le western de cette époque est perçu comme un western intellectuel et qui s’interroge sur lui-même. « Le sur-western apparut donc comme la réflexion d’un genre sur lui-même, sur ses sources, ses données, la signification de ses redites. En même temps qu’ils voulaient restituer le fait historique en le débarrassant de son aura légendaire, les auteurs du sur-western cherchèrent à démonter le mécanisme de cette légende afin d’en saisir les véritables implications et, bien souvent, les réfuter » (Le Western, Que Sais-Je?, p. 75).
Le héros de Anthony Mann sont probablement parmi les plus représentatifs de ce moment. Il n’est plus sans peur et sans reproche, il n’est plus jeune, beau et éternel. « Le héros mannien est un homme têtu, renfermé et un individualiste forcené qui, au début du film, ne recherche que son intérêt, qu’il soit motivé par l’appât du gain ou par le goût de la vengeance. A égale distance du Bien et du Mal, le choix final de son camp ne relève que de son libre arbitre, et celui qu’il devra combattre sera bien souvent son frère, son ami ou son complice. Le héros mannien est un personnage torturé qui se remet sans cesse en question, malgré une apparente solidité; mais qu’une circonstance particulière intervienne et il perd tout contrôle de lui-même. Aussi ne trouvera-t-il son équilibre que lorsqu’il aura dominé ses démons. Certain qu’il peut survivre seul à condition d’être le plus acharné et le plus fort, il doit perdre sa pseudo-invulnérabilité en étant humilié ou blessé avant d’aller vers la communauté dont il s’est d’abord détourné » (Le Western, Que Sais-Je?, pp. 82-83). Le Train Sifflera Trois Fois de Fred Zinneman (1952) appartient à cette veine.
Le western européen
Face au succès du genre, les européens se mettent eux aussi à faire du western. En Italie, cela devient même une industrie à part entière (qui remplace d’ailleurs le péplum décadent). C’est pourquoi on l’appelle communément le western spaghetti. Le premier western italien fut tourné en 1962, mais le véritable démarrage de la production eut lieu en 1964 (20 films dont un de Sergio Leone). Au départ, les auteurs, réalisateurs ont pris des noms américanisés et ont engagé des acteurs américains.
Le maître incontesté de la vague reste Sergio Leone (avec Clint Eastwood en acteur phare). Dans ses films, la violence est gratuite, les plans chocs, la perversion est partout. C’est le seul que Christian Gonzalez sort du lot. Selon lui, tous les autres réalisateurs copient Leone et les films sont médiocres. Il considère que le parti pris parodique choisi par les européens tient la route un instant, mais tombe vite dans une caricature sans relief. Les années ’68 et ’69 marquent le point culminant de ce western, mais en dix ans, le filon est épuisé.
Le western post-seventies
Le livre de Christian Gonzalez a été publié en 1979, il ne peut donc pas juger des derniers avatars du western comme Danse Avec Les Loups ou Brokeback Mountain par exemple. Mais il note que, faute de pouvoir se renouveler, le genre s’éteint petit à petit. Seuls trouvent un intérêt à ses yeux ce qu’il appelle les westerns crépusculaires.
« Célébrant les funérailles du Vieil Ouest et la mort de ses héros, le western crépusculaire emprunta des chemins d’un réalisme sordide pour annoncer qu’à l’Ouest l’aventure était finie. Dans les mains arthritiques des cow-boys centenaires les Winchesters étaient rouillées et les fabuleux héros du Far West avaient sombré dans le gâtisme et la décrépitude entraînant dans leur déchéance les mythes de la conquête qu’une génération de cinéastes, depuis 1950, avait passés au crible d’une critique acerbe et décapante} » (Le Western, Que Sais-Je?, p. 107).
Plus qu’un passage de mode, l’auteur voit dans ce phénomène une remise en question de l’Amérique toute entière. « Avec le sur-western dans un premier temps, avec le western crépusculaire ensuite, l’analyse spectrale du genre à travers ses clichés et ses traditions est devenue une mise en pièces du rêve américain. A l’origine champion de l’Amérique triomphante et figé dans un conformisme rassurant, le western, sur le tard, a embrassé la cause de la contestation. En passant par la démythification de la légende du Far West et en s’appliquant à montrer de l’intérieur une civilisation qui se défait, le western a remis en question les idéaux forgés du temps de la conquête et auxquels l’Amérique se référait encore. Dans ce passé tout proche, où s’est constitué la société américaine, le western, désormais, part à la recherche de la genèse des maux qui pourrissent l’Amérique contemporaine » (Le Western, Que Sais-Je?, p. 115).
Deadwood et le western
Deadwood appartient probablement à cette veine du western crépusculaire comme l’appelait Christian Gonzalez. La remarque de Sandy Gillet est pertinente quand elle dit que « Deadwood, c’est aussi la vision d’un monde en devenir, d’une société en quête de la célèbre `Frontière´, non pour en être l’un des derniers témoins à l’instar du lieutenant John Dunbar dans Danse Avec Les Loups, mais bien pour être le véritable artisan de sa disparition » (ecranlarge.com).
Deadwood se déroule dans le décor typique du western: l’Ouest sauvage, avec ses lieux mythiques comme les saloons, les rues arpentées par les chariots et les chevaux. On retrouve aussi les lieux communs du genre: les duels au fusil, les affrontements avec les indiens, les parties de poker, les chapeaux, bottes, et colt. On croise aussi les figures traditionnelles: l’indien, la fille de joie, le chercheur d’or…
Mais Deadwood se caractérise surtout par les distances qu’elle prend avec le genre. D’abord, ses personnages principaux ne sont pas ceux du western. On ne voit pas de cow-boy, les chercheurs d’or ne sont que secondaires. Finalement, ce sont les professions libérales qui tiennent le haut du pavé: les commerçants (quincaillers, propriétaires de saloon), le docteur, le journaliste,…
Et les femmes y ont beaucoup plus d’importance qu’avant. Trixie, la prostituée, Alma, la riche propriétaire sont au centre de la narration et non de simples ornements. La fiction se permet même de prendre une femme comme représentante de la légende: Calamity Jane.
Quand ils ressemblent à des héros typiques, les personnages souffrent de faiblesses. Seth Bullock est le shérif idéal, mais il nous cache quelque chose. Sa colère est malsaine. On se demande même s’il ne ressemble pas à Al. Bill Hickok est un mythe, mais un mythe sur le déclin. Non seulement, il passe son temps à boire, à jouer et à perdre, mais en plus il est suicidaire. Hickok avait vu venir le coup qui l’a tué et il n’a rien fait pour esquiver. Calamity Jane est rongée par l’alcool.
Ce que nous raconte Deadwood, enfin, n’a rien a voir avec les thèmes caractéristiques. Deadwood ne suit pas le combat d’un shérif pour faire respecter la loi. On ne s’intéresse pas à la guerre qui oppose l’armée aux indiens. On ne se focalise pas sur la recherche d’or. Ce qui semble être le centre des intrigues, c’est la constitution d’une communauté et son organisation.
« Deadwood parle de la naissance d’une démocratie et de la création de la société américaine: pourquoi nous créons des gouvernements, pourquoi nous entrons en relation avec d’autres hommes (…) C’est une occasion d’observer comment toutes ces personnalités vont se réunir et d’observer pourquoi ils ont besoin de règles d’organisation pour les guider, afin de les empêcher de simplement s’entre-tuer » (traduction personnelle des propos tenus par Gregg Fienberg sur le site officiel de la série hbo.com).
C’est probablement ce qui fait dire à John Leonard que « Deadwood, située dans les Black Hills du Dakota, quelque part entre Casablanca et `No Exit´, est le trou du cul du Vieil Ouest » (sur newyorkmetro.com), tant les personnages sont piégés dans une souricière surpeuplée!
Plus que de s’éloigner des thèmes et des personnages traditionnels, Deadwood semble aussi réhabiliter certains oublis. D’abord on apprend que les villes de l’Ouest étaient déjà multiculturelles. Deadwood compte une communauté chinoise assez importante. On remarque très vite que les asiatiques ne se mélangent pas aux occidentaux. Le racisme est latent et une étincelle peut mettre le feu aux poudres.
Les blancs ne sont d’ailleurs pas un peuple homogène. Sol Star est Autrichien et juif (source également de remarques racistes). Merrick a des descendants irlandais. L’immigration est importante. On ne remarque cependant pratiquement aucun personnage noir.
Ensuite, on comprend que l’époque est encore marquée par la sauvagerie de la guerre civile. Le docteur y fait souvent allusion. L’alcoolisme de Calamity Jane en est probablement une autre conséquence. Contrairement aux idées reçues, la guerre de Sécession a donc fait des dégâts psychologiques.
Autre innovation: les femmes, bien que peu nombreuses, elles ont un certain pouvoir. Joanie monte sa propre affaire sans que cela ne semble une hérésie. La personne la plus riche de la ville, grâce à la concession de son mari, est Alma Garrett. Trixie, bien que prostituée et « appartenant » à Al, a son mot à dire. Cette vision de la condition de la femme est peut-être anachronique cependant…
Enfin, Deadwood nous fait remarquer que le western était une époque pas si cool que ça. Les villes se résument souvent à des cloaques enfoncées dans la boue. L’hygiène y est déplorable. On voit pratiquement toujours Al se lever et se coucher. A aucun de ces moments, il ne se lave. Les filles du saloon sont sales. La petite vérole se répand rapidement. L’alcool fait des ravages. Les gens sont grossiers (Jane représentant le summum du juron!).
La grossièreté est d’ailleurs l’élément principal des mauvaises critiques récoltées par le programme aux Etats-Unis. C’est toujours Shawn McKenzie qui nous l’apprend sur le site entertainyourbrain.com. Cela ne nous étonne pas vraiment d’ailleurs. Shawn s’oppose à ses critiques et fait remarquer que les recherches menées sur l’époque démontrent que les gens ne s’exprimaient pas vraiment comme des livres de grammaire.
Tom Shales du Washington Post précise d’ailleurs qu’il y voit une certaine poésie: « Deadwood est magnifiquement graveleux et poétiquement obscène dans son langage. Personne ne dit des choses aussi simples que `j’ai faim´ sans qu’un juron notoire ne se glisse entre le premier et le troisième mot. Mais on s’y fait et, en fait, cela en devient presque lyrique » (washingtonpost.com).
Deadwood et la réalité
Il existe réellement une ville nommé Deadwood aux Etats-Unis. Elle est réellement née de nulle part en quelques mois en 1876. Les casinos sont toujours des lieux incontournables de la ville, c’était déjà le cas au 19ème siècle. En 1989, Deadwood devient la troisième ville des Etats-Unis à légaliser le jeu. Le but était de revitaliser la région.
Depuis la ruée vers l’or jusqu’à aujourd’hui, le destin de la ville semble donc lié à l’argent. Bill Hickok et Calamity Jane y sont réellement allés et y sont morts. La fiction mélange des personnages réels avec des personnages imaginés. Calamity Jane, Bill Hickok, Seth Bullock, Sol Star, Al Swearengen, Jack McCall (le meurtrier de Hickok), Charlie Utter, Trixie, EB Farnum, Dan Dority, Merrick, le révérend Smith, par exemple, ont réellement existé.
Shawn McKenzie, sur le site entertainyourbrain.com, déclare que c’est le western le plus réaliste jamais créé. Pourtant le réalisme, ou plutôt la manière de le mener, a également alimenté les critiques, selon McKenzie. David Milch s’est lui-même défendu contre cela. Il n’a jamais prétendu faire un docu-drama. Il s’est énormément documenté sur les vies réelles des gens dans le Deadwood du 19ème siècle. Il a par exemple lu le journal de l’époque, le Black Hill Pioneer. Mais il a condensé les faits sur un petit nombre de personnages et sur un temps limité pour ne pas ennuyer le téléspectateur.
Le langage utilisé renforce encore le réalisme. Les critiques américains qui ont vu la série en anglais prétendent que les dialogues font penser aux romans de James Fenimore Cooper (newyorkmetro.com). Ian McShane souligne également le don de David Milch pour les dialogues « dix-neuvième » dans une interview publiée sur le site d’HBO…
Ainsi que les décors: Gregg Fienberg prétend que David Milch a eu des idées d’intrigues rien qu’en marchant sur le plateau. L’équipe a d’ailleurs tourné dans un décor en construction pour rendre visible l’expansion de la ville. « C’était une ville qui est passée de zéro à 10.000 habitants en 6 mois. Nous essayons de le montrer. Des bâtiments étaient construits tous les jours à différents endroits et nous essayons de faire sentir ce qui se passait dans cette ville. On tourne continuellement dans une rue du plateau et les décorateurs sont à côté de nous en train de construire le décor que nous utiliserons ensuite ou celui qui est sensé ressembler à un bâtiment en construction. Cela crée quelques problèmes quand on filme, parce qu’ils doivent travailler entre les prises » (traduction personnelle des propos de Gregg Fienberg publiés sur le site hbo.com. Deadwood, la ville, les bâtiments et les rues, sont d’ailleurs les seuls éléments présents à l’image durant le générique. Bel hommage au lieu!
La production
David Milch a commencé sa carrière de scénariste en écrivant un épisode de Capitaine Furillo en 1982. A l’époque, c’était surtout un professeur de littérature anglaise à l’université de Yale. Il met alors un terme à sa carrière académique et passe 5 saisons sur la série de Steven Bochco. Il termine producteur exécutif.
Il crée ensuite un spin-off de Capitaine Furillo, Beverly Hills Buntz et une nouvelle série, Capital News. En 1992, il refait parler de lui grâce à New York Police Blues, toujours avec Steven Bochco. Ils poursuivent leur collaboration sur Brooklyn South, Murder One et Total Security. Il a depuis monté sa boite de production (Redboard Production) et créé les fictions Big Appel et Deadwood.
Gregg Fienberg est producteur exécutif sur Deadwood. Il a auparavant participé à Twin Peaks, Seaquest DSV et Carnivàle. Il a également produit des films, notamment U2: Battle & Hum, Twin Peaks: Fire Walks With Me.
Pour les CV des acteurs qui jouent dans Deadwood, je vous renvoie au site officiel de la série. HBO a, en effet, l’habitude de mettre en ligne des informations tellement complètes que je ne veux pas jouer les doublons (hbo.com).
Deadwood: critique
Deadwood est une série qui vaut vraiment la peine d’être vue. Je la trouve personnellement très, très convaincante. Mais ce n’est pas nécessairement une série facile à regarder. D’abord parce qu’il y a tellement de personnages et donc de détails, de noms, de situations à retenir qu’il faut un certain temps avant de s’y retrouver. Par conséquent, les premiers épisodes sont très lents. J’ai l’habitude de prendre des tonnes de notes quand je regarde une série. Pour Deadwood, je n’ai pratiquement rien écrit avant la mort de Bill Hickok!
On a parfois l’impression de ne pas saisir le propos principal de la série. Est-ce la mort de Hickok? Est-ce la lutte contre la petite vérole? Est-ce l’opposition Al-Bullock? Est-ce l’accession de Bullock au poste de shérif? Sont-ce les histoires d’amour de Seth et Sol (toutes deux vouées à l’échec puisque Seth est marié et Trixie une pute soumise à Al)? Il faut un petit temps pour comprendre que c’est un peu de tout ça, mais surtout les relations entre les gens qui sont importantes. Une fois qu’on a compris cela, la série accroche irrémédiablement.
Deadwood fonctionne aussi comme une partie de poker: il faut accepter de jouer sans avoir toutes les cartes en main et en sachant que l’adversaire bluffe. Dans Deadwood, on ne comprend pas toujours les motivations des personnages (par exemple les liens qui unissent et divisent en même temps Cy, Joannie et Eddie). On sent qu’on nous cache des choses. Finalement, la narration ressemble fort à celle de Twin Peaks. Le téléspectateur doit accepter d’être frustré.
Deadwood, la suite: saisons 2 et 3
Le cap de la première saison passé, Deadwood reste toujours formidablement écrite, formidablement jouée, drôle, émouvante parfois, crispante dans certaines scènes plus dures. Mais il y a toujours un truc qui m’échappe… Qu’est-ce que Milch veut nous raconter? Sérieusement.
Pour la première saison, on a pu lire que la série s’intéressait à une ville avant qu’elle n’entre sous le contrôle du gouvernement des Etats Unis et donc de la loi. Ok. Mais, depuis trois saisons, Al, Cy et Seth se supportent quand c’est dans leur intérêt tout en s’observant du coin de l’oeil. Vous n’avez pas l’impression qu’on est face à un formidable statu quo depuis le début? Moi oui.
On prend les mêmes et on recommence. La seconde saison de Deadwood ramène le téléspectateur dans la petite ville « hors la loi ». On retrouve les personnages, la boue, les rues encombrées. Bullock écartelé entre Alma et Martha, son épouse qui a débarqué avec William, son fils. Trixie qui semble encore hésiter entre son statut de prostituée alliée à Al et la vie que peut lui proposer Sol. Joanie ouvre son propre bordel, mais cela ne signifie pas que son destin est détaché de celui de Cy Tolliver.
Charlie est l’assistant de Seth dans sa fonction de shérif. Les amitiés, parfois étonnantes, se lient entre Alma et Trixie, Joanie et Jane. Certains personnages présents déjà la saison précédente prennent de l’importance à l’instar de Hellsworth qu’on n’attendait pas en époux bourgeois. Je ne vais pas vous dévoiler tout ce qui arrive à ces personnages. Sachez seulement, que l’innocence n’a pas sa place à Deadwood.
Si tous les épisodes se déroulent toujours dans la ville, l’impression de huis-clos se dissipe un peu. La ville s’ouvre sur l’extérieur. La construction du télégraphe symbolise ce changement dès le premier épisode de la deuxième saison. On l’avait compris à la fin de la première saison, Deadwood ne pourra pas éviter d’être rattachée aux Etats Unis. La question est: comment ses habitants vont-ils s’arranger pour ne pas perdre des plumes dans la transaction?
De nouveaux personnages viennent donc compliquer les jeux de faux-semblants, les mensonges, les associations secrètes qui avaient déjà cours à Deadwood. Les envoyés des politiciens mettent la pagaille. Un nouveau clan chinois marche sur les plates-bandes de Wu. Le psychopathe Francis Walcot démontre que la ville n’avait pas encore atteint le comble de l’horreur. L’industriel George Hearst est en passe de faire passer Al pour un enfant de choeur.
La troisième saison se développe dans l’exacte continuité puisqu’elle raconte principalement l’affrontement entre Hearst et tous les autres. L’homme d’affaire veut mettre la main sur la propriété d’Alma. En passant, il tente d’imposer sa loi à la ville. Les chefs locaux (Al, Cy et Seth) se sentent menacés. On assiste donc au combat entre les méchants et le très méchant.
Il y a des choses intéressantes dans la troisième saison. Le personnage de Martha prend un peu d’épaisseur. Jusque là, elle semblait surtout faire partie du décor. La troupe de théâtre qui débarque est constituée de personnages plutôt colorés. Ils organisent notamment une soirée où les habitants de Deadwood peuvent montrer leurs talents artistiques. C’est rigolo.
L’amitié entre Jane et Joanie s’approfondit. Il semble bien qu’on se dirige timidement vers une relation lesbienne. On pouvait le pressentir dans la deuxième saison. Tante Lou, la cuisinière noire de Hearst est aussi une jolie surprise. Surtout quand elle parle avec Richardson, l’homme à tout faire un peu simplet qui travaille à l’hôtel et qui idolâtre la tête de cerf. Enfin, je dois dire que je trouve le personnage du télégraphiste russe attendrissant.
Cependant d’autres personnages deviennent un peu opaques. Alma reste une énigme. Elle semble à la fois tomber sous le charme de son mari Hellsworth tout en gardant une réserve. Elle semble enfin avoir tout pour être heureuse, mais fout tout en l’air à cause de son addiction au laudanum. Elle ne veut pas vendre sa parcelle à Hearst sans qu’on comprenne pourquoi elle s’attache à ce lopin de terre. Elle semble plus intéressée par la banque, alors pourquoi ne pas vendre?
Le personnage de Cy Tolliver est un peu bizarre. Parfois, il est alité, parfois il va mieux, puis il retourne au lit… Il est ami avec Joanie, il la déteste. Il est ami avec Hearst, il s’associe à Al et Seth. Le personnage est plutôt incohérent.
Wyatt Earp et son frère font une visite éclair à Deadwood. Ils mettent un peu le bordel avant de partir sans demander leur reste. De nouveau, on ne voit pas bien où cela nous mène.
Il y a aussi la danseuse exotique de la soirée de théâtre et la femme en rouge (sont-ce les mêmes? je ne crois pas) dont on ne sait absolument rien et pourtant la caméra insiste assez sur elles pour qu’on s’interroge. Les autres sont égaux à eux-mêmes. Sol la ferme, Al dirige, Farnum manigance, Cochran soigne, Trixie râle, Seth enrage, Jane boit, Charlie fait tapisserie…
Tout ça manque un peu de motivation. Milch ne nous en dit pas assez pour qu’on comprenne vraiment ce qui se passe. Que veut Alma? Que cherche Cy? Pourquoi la troupe de théâtre est-elle là? Pourquoi les relations entre les acteurs sont-elles si bizarres? Qui est le mourant si important pour les autres? La narration est aussi trop éclatée. Il y a finalement tellement de personnages auxquels il arrive tellement peu de choses qu’on est plus face à un tableau impressionniste qu’autre chose.
A la fin des trois saisons, j’ai l’impression d’un statu quo un peu stérile. Deadwood est finalement à l’image des phrases trop jolies, trop polies, trop chargés d’implicites qu’échangent Seth et Martha… On se demande où cela mène. Après trois saisons, je n’ai toujours pas l’impression que la série a débuté. Et je commence à avoir l’impression de perdre mon temps en la regardant. C’est un peu embêtant. D’autant qu’apparemment je suis la seule à penser ça puisque tout le monde encense la série.
J’ai cherché dans les critiques l’argument massue qui me permettrait de comprendre où se situe mon erreur. Mais sans trouver. Tout le monde souligne l’idée de départ, la finesse des décors, le côté rigolo du style qui mélange le langage shakespearien et les jurons, les personnages décalés, mais je ne décèle pas vraiment d’argument qui m’expliquerait en quoi on est face à une grande série. Tout les éléments présents dans les papiers expliquent en quoi la première saison était une découverte… Mais on aurait dû passer à autre chose maintenant!
C’est peut-être ce qui explique la baisse d’audience dont souffre la série aux Etats-Unis. Si la série obtient un succès critique qui ne se dément pas, le nombre d’abonnement ne suit pas et la fiction coûte trop cher à la chaîne (5 millions), les tournages sont trop longs (le double d’une série habituelle) et le casting rassemble trop d’acteurs (une vingtaine).
Tout ceci a décidé HBO à ne pas renouveler la série pour une quatrième saison. On a parlé d’un arrêt, d’une demi-saison… Une solution rejetée par David Milch.
La série aurait dû se clôturer par deux téléfilms de deux heures chacun qui finalement ne verront jamais le jour… Il faudra se contenter des 36 épisodes des 3 saisons déjà tournés…
En quelques mots...
Sarah Sepulchre
Alexandre Marlier
Deadwood
Pour une fois qu'on nous parle du Far West sans trop de duels de cinéma... Le souci, c'est que la série s'embourbe autant que la ville de Deadwood. Regardez quand même la première saison.